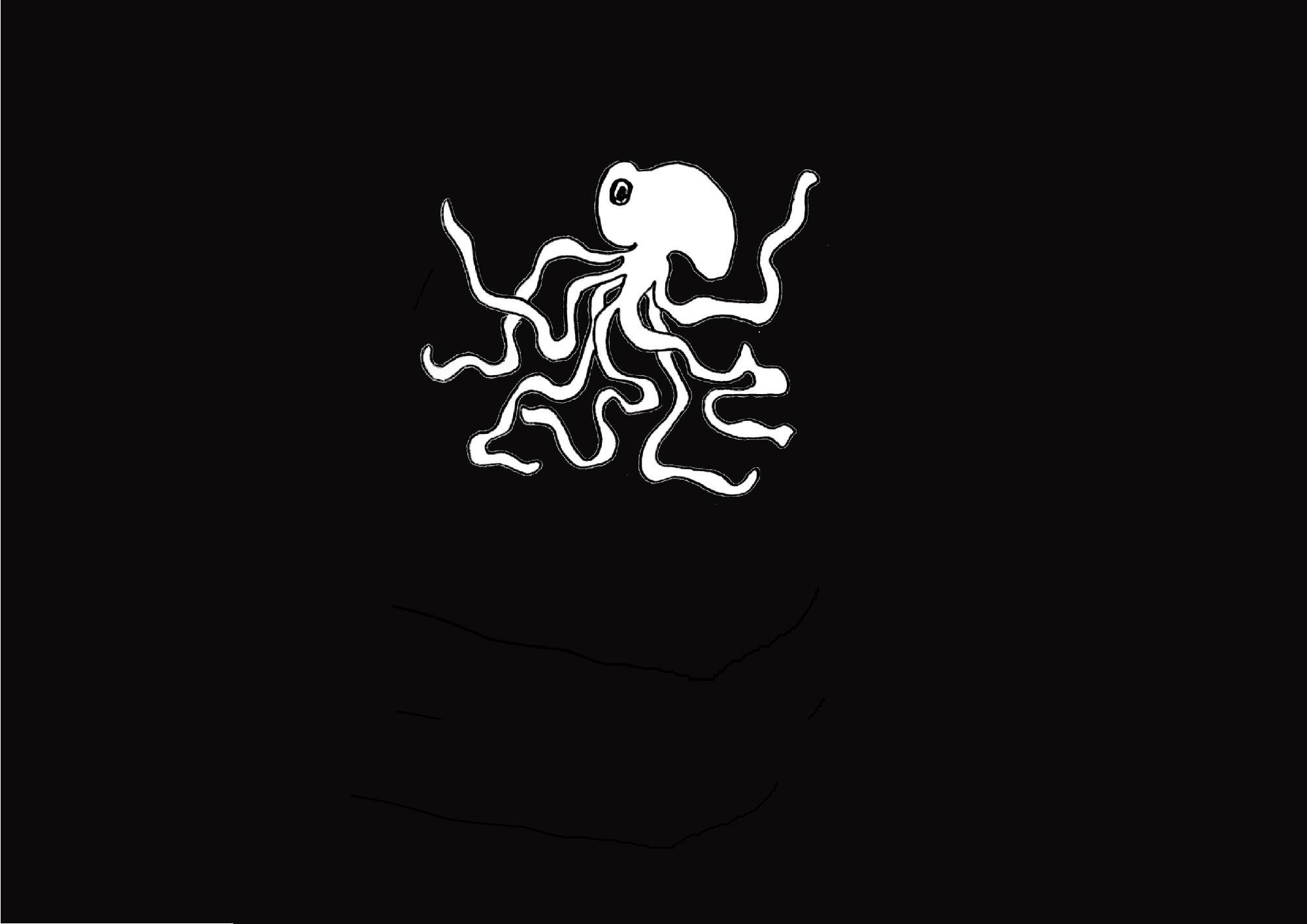Cette courte contribution est une réponse à l’intervention “L’ennemie est à l’intérieur” d’Houria Bouteldja lors du meeting d’ouverture de Guerre à la guerre le 20 juin 2025.
Avant toute chose, je tenais à noter qu’Houria Bouteldja est une militante et théoricienne décoloniale que j’estime énormément. Je ne dis pas cela pour la flatter, mais plutôt parce que j’ai pu lire bien trop souvent des critiques malhonnêtes de son travail qui reposaient avant tout sur une diabolisation de sa personne. La critique que je vais tenter d’esquisser ici se veut à l’inverse bienveillante et surtout constructive. Je tenais aussi à lui apporter tout mon soutien face à la censure dont elle a encore fait l’objet de la part de l’université Dauphine et l’UD CGT 75.
Comme en témoigne la mobilisation contre le salon du Bourget organisée par la coalition Guerre à la Guerre, la question de l’antimilitarisme et avec elle de l’anti-impérialisme, connaît un nouveau souffle (dans les organisations d’extrême gauche tout du moins). Le génocide en Palestine (et les mobilisations massives à peine quelques jours après le 7 octobre) mais aussi l’invasion russe en Ukraine, ont forcé la gauche à ré investir ces questions, ce qui a pu amener à des positionnements théoriques et stratégiques divergents.
Pour Houria Bouteldja, et il me semble que c’est une ligne plutôt partagée par l’ensemble de l’équipe du média décolonial Paroles d’Honneur, pour construire un anti-impérialisme conséquent, il faut commencer par désigner son ennemi principal, et, en ce qui nous concerne nous, “Français ou vivant en France”, “c’est tout à la fois l’Occident, l’Europe et la France.” Ce postulat est avant tout stratégique car selon Houria “nous manquons de munitions et qu’une économie militante précaire nous oblige à prioriser nos cibles. ” (Citations extraites de l’intervention d’Houria et à retrouver ici : https://qgdecolonial.fr/lennemi-est-a-linterieur/)
Bouteldja se place sur un plan stratégique, et c’est sur ce même plan que je vais tenter de lui répondre. Pour commencer, je lui accorde volontiers que nous manquons de force et que cela implique une pensée stratégique et réaliste (c’est-à-dire en adéquation avec nos capacités actuelles). Je tiens cependant à faire remarquer qu’une pensée stratégique ne doit pas faire l’économie d’une analyse à moyen/long terme. C’est ici que se trouve à mon sens un point aveugle. En partant de l’analyse évidente que l’Occident a réussi à imposer par la force et la destruction, un système monde écocidaire, suprémaciste et sexiste, on peut être tenté de ne pas prendre au sérieux le fait que des puissances concurrentes prédatrices ont réussi malgré tout à résister à cette hégémonie occidentale. Ces nouvelles puissances, qui s’auto proclament axe de la résistance à l’impérialisme occidental (Iran-Chine-Russie), tentent de capter les ressentiments anti occidentaux planétaires (qui ne sont que la conséquence logique de l’impérialisme occidentale) pour à leur tour légitimer la défense de leurs propres intérêts Or, ces intérêts n’ont rien à voir avec les intérêts des populations de ces pays en question. En Iran, en Chine et en Russie, l’opposition est muselée, les libertés individuelles sont attaquées, les minorités ethniques sont discriminées (voir pire avec les Ouïghours en Chine). Bien sûr, aujourd’hui, la capacité de nuisance à l’échelle planétaire de ces trois pays n’est en rien comparable avec celle de l’Occident. Mais pour combien de temps encore ?
Là où me semble être le point aveugle d’Houria Bouteldja (et plus généralement de Paroles d’Honneur) c’est que même si le sentiment légitime de haine de l’occident contribue bel et bien à affaiblir les puissances occidentales (ce qui est bien évidemment un de nos objectifs en tant qu’anti impérialistes) il peut s’accompagner d’un sévère retour de bâton. En l’occurrence, que serait un monde dominé par la Russie, la Chine et l’Iran ? On peut déjà commencer à l’apercevoir au Sahel, où la présence française ne fait certes que s’amoindrir mais pour ne laisser que plus de place à une puissance rivale : la Russie (et notamment par le tristement célèbre groupe Wagner). Les exactions des mercenaires Russe envers les minorités ethniques n’ont pas tardé dans la région , pourtant, la présence Russe au Sahel continue à être largement acclamée par une partie de la population locale car la Russie a su parfaitement s’appuyer sur les affects anti français pour dissimuler ses propres atrocités.
Quelle en est la lecture d’Houria Bouteldja ? Qu’il s’agit d’une victoire pour notre camp car c’est un revers pour notre impérialisme Français ? Qu’en tant qu’anti-impérialiste française, elle doit prioriser ses cibles, que son ennemie principale c’est l’impérialisme Occidental et qu’elle n’a donc pas à se positionner sur la question ? Je lui répondrais alors, que, dans la ville où j’habite, Montreuil, près de 10 % de la population est Malienne. Qu’ainsi, l’avenir de ce pays, qu’il soit sous le joug de l’impérialisme Français ou Russe, restera un enjeu premier pour un grand nombre de personnes habitant cette ville.
Mais attention, il ne s’agit en aucun cas de dire qu’il faudrait faire la leçon à toutes celles et ceux qui se réjouissent du départ des troupes françaises au Sahel et de l’arrivée des troupes Russes. Les peuples du Sahel doivent pouvoir s’autodéterminer et sont ainsi légitime à nouer les alliances qu’ils souhaitent à cette fin. Tout comme aujourd’hui, l’Iran est légitime à se défendre face aux agressions d’Israël. Là où nous devons être vigileant.es, c’est à ne pas participer à faire passer la Chine, l’Iran et la Russie comme contre modèles dans le but de servir nos intérêts immédiats.
A ce titre, certaines interventions du média Paroles D’honneur me semblent particulièrement dangereuses. Dans un récent plateau (min 25) , Youssef Boussoumah s’attaque au mot d’ordre “ni Netanyahu, ni Khomeini” reprit dans certaines manifestations, en argumentant qu’il ne serait venu à personne, au moment de la guerre du Vietnam, de mettre sur le même plan Nixon (le président américain de l’époque) et Ho Chô Minh ou bien Nixon et Fidel Castro . Insidieusement, Youssef épouse la rhétorique selon laquelle Khomeini, Poutine et Xi Jinping seraient des anticolonialistes, comparable à Castro et Ho Chi Minh, dont l’autoritarisme ne serait qu’une contradiction situationnelle. C’est ainsi faire fi des différences profondes de nature entre des projets communistes portés par Ho Chi Minh ou Fidel Castro, et des projets capitalistes et autoritaires, portés par Poutine, Khomeini et Xi Jinping. Par ailleurs, et c’est une autre différence notable avec Cuba sous Fidel Castro ou le Vietnam d’Ho Chi Minh, la Chine est en phase de devenir la première puissance économique du monde. Or, dans un monde dominé par le capitalisme, la première puissance économique mondiale ne peut être qu’impérialiste (quelque chose d’étrange à rappeler à des marxiste-léninistes).
Dès lors, il est de notre responsabilité, en tant que militant.es anti-impérialiste, de ne pas répandre la stratégie de communication de la Chine, de l’Iran et de la Russie qui aiment à se faire passer pour des puissances anti coloniales car anti occidentales. Nous pouvons avoir un rapport dialectique à la chose : oui l’occident est aujourd’hui (et historiquement) l’agresseur premier, mais non, un nouvel ordre mondial dominé par un auto proclamé axe de la résistance, n’est en rien une défaite de l’impérialiste (et du colonialisme) et une victoire pour les peuples. Le nouvel ordre mondial que la Chine, l’Iran et la Russie veulent imposer, se fera nécessairement au détriment des peuples tout comme il se fait déjà au détriment des ukrainiens, des ouïghours, des kurdes…
Et c’est bien là, il me semble, où la rhétorique d’Houria Bouteldja et de Paroles d’Honneur est défaillante sur le plan stratégique. Une fois, la Russie, la Chine et l’Iran érigés en contre modèle (et je crois sincèrement que des interventions comme celles de Youssef Boussoumah y participent), il devient alors très compliqué de construire des solidarités avec les collectifs qui luttent, notamment depuis la France, pour plus de liberté et plus de droits au sein de ces pays, car on est alors taxé de faire le jeu de l’Occident. C’est par exemple ce qu’il s’est récemment passé lors d’un rassemblement pour la Palestine, lorsqu’une militante du collectif féministe Iranien ROJA a demandé à ce que soit retiré des drapeaux de la république islamique d’Iran . Cette demande a été vivement critiquée par certains participants qui ont vu là un manque de solidarité envers la Palestine (alors même que le collectif participe depuis des mois aux manifestations pro Palestiniennes).
L’injonction à définir l’Occident comme notre seul ennemi principal, nous coupe (et d’autant plus dans un monde qui devient multipolaire) de certains peuples (et diasporas) en lutte à travers le monde (et en France) qui n’ont pas nécessairement les mêmes priorités stratégiques que nous. Des syrien.nes, des iranien.nes, des soudanais.es sont arrivées par centaine de milliers en France depuis des années. Leurs causes et leurs intérêts doivent pouvoir exister dans le mouvement anti-impérialiste que nous tentons de construire et nous n’en ressortiront que plus fort.es.
Notre ennemi principal, c’est l’impérialisme et le colonialisme sous toutes ses formes, aussi bien passées que contemporaines qu’à venir, et notre victoire reposera sur notre capacité à tisser des liens à la base, entre les peuples, malgré ce qui, de prime abord, peut nous placer dans des camps opposés. Les allié.es sont partout, à nous de les reconnaitre.
C’est en tout cas le pari du réseau internationaliste des Peuples Veulent , composé à la fois d’exil.ées de nombreux pays et de dissident.es occidentaux et dont la pratique politique peut se résumer ainsi :
Seul les peuple sauvent les peuples
Alors à quand un plateau avec Roja ou les Peuples Veulent sur Paroles d’Honneur ?