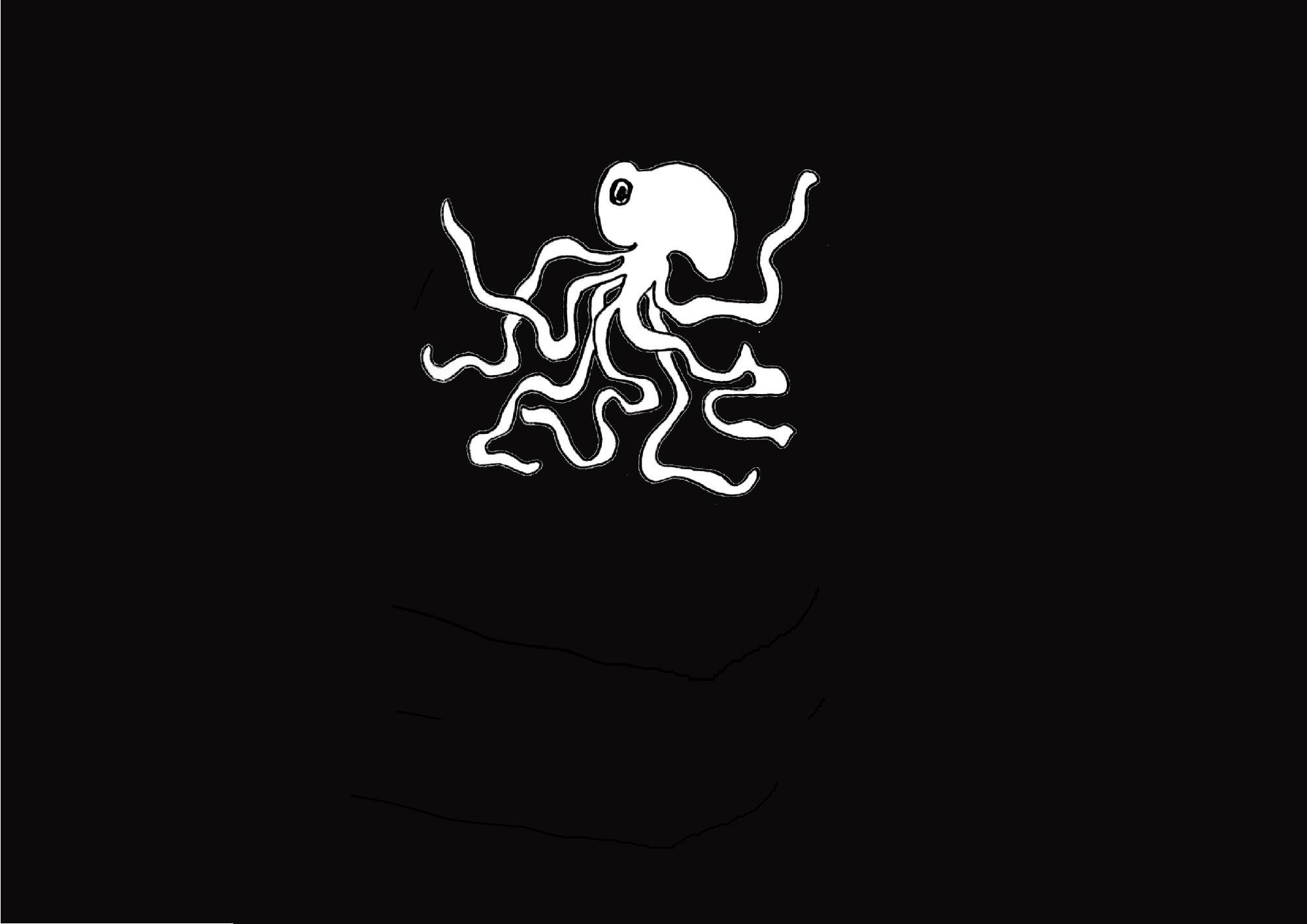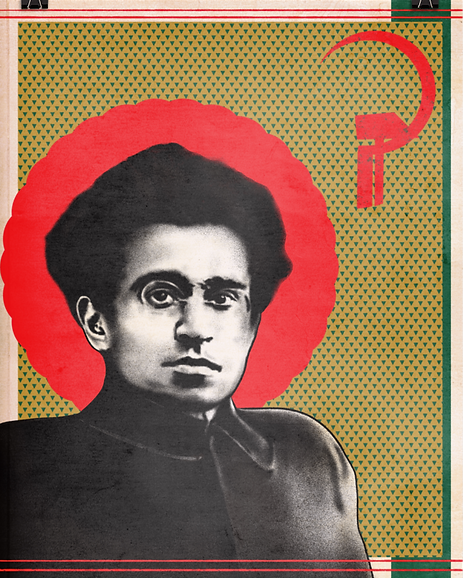La proposition de nation décoloniale d’Houria Bouteldja a fait couler beaucoup d’encre. Il ne s’agira pas ici de revenir en détail sur cette proposition que la militante décoloniale a pu développer dans son intervention lors du meeting « L’alliance des tours et des bourgs ? Chiche ! » et retranscrite sur la revue contretemps .
Bien que je partage avec Houria la nécessité d’aborder la question des attachements et des affects, ma culture militante « autonome » me fait aborder avec appréhension la question de la nation, fût-elle décoloniale, qui s’accompagne inévitablement, et d’autant plus lorsqu’elle est portée par une militante marxiste-léniniste, de la question de la prise du pouvoir. C’est lors d’un plateau sur le média Paroles d‘Honneurs à propos du livre Clarifications (conversation entre Alain Brossat et Houria Bouteldja, éditée par les éditions Météores) qu’un riche échange s’est tenu faisant dialoguer la proposition d’Houria avec d’autres traditions de pensée dont je peux me sentir plus proche (Stengers, Haraway …). Le texte qui suit est donc une retranscription légèrement modifiée de l’échange qui s’est déroulé lors de ce plateau entre Olivier Marboeuf, écrivain Guadeloupéen, Mirabelle Thouvenot, contributrice au QG décolonial et Julien Théry et Pierre-Aurelien Delabre, deux compagnons de route du mouvement décolonial.
Olivier Marboeuf
La proposition d’Houria Bouteldja, c’est d’essayer d’avoir une lecture de la complexité des affects et des modes d’attachement humain pour avoir un élément de convergence de pure humanité, au sens humaniste, au sens presque radical du terme. C’est-à-dire, qu’est-ce qui constitue des humanités qui peuvent se retrouver parce qu’elles se reconnaissent dans des modes d’attachement qui, s’ils ont des objets différents, ont des modes en commun. C’est intéressant parce que ça révèle la manière dont, dans le camp indigène on a investi la question des affects dans la stratégie politique. Et comment Alain Brossat n’arrive pas du tout avec cette catégorie-là en particulier. C’est peut-être l’endroit sur lequel certains marxistes blancs ont dit, là il y a un truc, il faut revisiter la question des traditions, il faut essayer de regarder au niveau de certaines formes d’affects qui peuvent avoir des enjeux politiques forts. Lui (Alain Brossat), il est presque dans le mépris des affects populaires, ce qui mène à une impasse car tout se joue à cet endroit-là. Par exemple, Alain Brossat n’identifie pas, même quand il va parler des quartiers populaires ou des populations indigènes, cet habité que ça constitue. Ces endroits où les gens ont produit de l’attachement avec du mal logement et où, quand on va détruire les tours à la Courneuve, les gens pleurent. Moi quand j’ai vu ça, je me suis dit, pourquoi personne ne saisit cette occasion politique de dire, mais c’est incroyable. On a fait des barres très dures, ils ont vécu là pendant 30 ans, on les détruit et ils pleurent. Donc il y a un mode d’attachement qui n’a pas fait terroir. Moi, à l’époque, je l’avais noté en me disant, il faut réussir à faire de cette urbanité des quartiers populaires, un terroir, c’est-à-dire une modalité d’attachement paradoxale. Et effectivement, c’est là qu’il y a quelque chose qui manque dans le raisonnement de Brossat, qui le rend un peu sec et qui confine à des formes de mépris. Ça montre qu’il n’a pas une attention sur ce que fabriquent les classes populaires et fabriquent au sens vraiment du bricolage, là où je pense que c’est aussi une échelle sur laquelle, dans les propositions d’Houria, il y a une un affinement à donner. J’ai un souci sur la question de l’échelle de la nation. C’est comme s’il y a une montée en échelle, et là je serais un peu dans la pensée de Donna Haraway pour le coup, où on est directement sur une échelle (celle de la nation) qui est pour moi signifiante dans une campagne présidentielle, mais dans une pratique je dirais un peu constructiviste d’une lutte, il y a beaucoup d’autres échelles qu’on doit convoquer.
Julien Thery
Là tu parles de la proposition d’Houria Bouteldja d’investir le national et la nation ?
Olivier Marboeuf
Oui et je me dis que la question de la nation elle peut être le résultat d’un tissage dans lequel il y a d’autres échelles sur lesquelles on peut, et peut-être on doit, travailler.
Mirabelle Thouvenot
Moi je crois que ça elle le dit aussi. Pour moi, la proposition d’Houria il faut la comprendre comme étant déjà une tentative de rabattre l’échelle européenne à une échelle inférieure. La question c’est à quelle échelle on va pouvoir revenir dans un premier temps ? Et même là dans le livre Clarifications, quand d’ailleurs Brossat interroge Houria sur cet aspect national, elle dit bien que ça n’exclut pas le fait de fabriquer des attachements à partir d’identités régionales et qu’il y a plein d’autres choses qui vont se mêler là-dedans. Mais qu’en tout cas c’est toujours la question de la stratégie dans l’immédiat pour se dire, où est-ce qu’on met la digue ? Où est-ce qu’on a le plus de chance de pouvoir réussir à empêcher le pire ? Donc moi je le comprends comme déjà une manière de rabattre à une échelle inférieure pour pouvoir ensuite aller vers des échelles encore plus basses.
Olivier Marboeuf
J’entends, mais je trouve que même la supputation d’un affect nationaliste dans les classes populaires blanches, moi je demande à ce qu’on vérifie ça. Je ne suis pas complètement convaincu que cet affect national surgit sans cadre régional, sans cadre corporatiste, sans cadre familial élargi, sans cousinage…Alors évidemment moi je viens d’une région française particulière sur laquelle on n’a pas un attachement de malade vis-à-vis de la nation française. On a un attachement à ce qu’on appelle les pays, c’est-à-dire un espèce d’attachement réciproque en rapport avec l’humain et le non-humain avec lequel on vit, où l’entretien et le rapport d’attachement est presque matériel. Quand on parle d’être ancré, ça veut dire qu’on est capable d’agir sur son environnement. Je trouve que lorsqu’on on vit dans des métropoles très construites, où les usages sont très décrits, ces attachements sont moins simples. Il faut trouver. Et par rapport aux gens dont on a détruit les tours en béton à la Courneuve, j’ai vu des capacités humaines d’attachement devant un livrable à vivre qui est vraiment le minimum de l’humanité et sur lequel les gens ont réussi à réinvestir des attachements. Donc ça, ça m’intéresse. Je dirais que la question de l’échelle nationale est nécessaire dans une urgence électorale, mais je pense qu’il y a beaucoup de niveaux d’attachement sur lesquels on peut presque créer des micro-consensus pour aller vers celui qui est le plus aigu.
Pierre-aurelien Delabre
Je pense que l’articulation justement entre ces formes infranationales, nationales et l’internationalisme c’est une articulation qu’on doit être en capacité de faire. Je pense que la proposition d’une nation décoloniale, le fait qu’il y ait décoloniale quand même dans la proposition, implique que ce ne sera pas seulement, de toute façon, une échelle nationale, des affects nationalistes, des affects populistes nationaliste disons. Ce sera forcément quelque chose qui devra se jouer à trois niveaux, à un niveau internationaliste, à un niveau national et à un niveau infranational. La question de comment agréger ces formes infranationales de façon décoloniale dans un cadre national avec une perspective internationaliste, ça c’est la question je crois qu’on doit essayer de se poser.
Olivier Marboeuf
Je pensais que la discussion entre Houria et Alain Brossat passerait plus de temps à négocier des modes d’attachement historiques du monde ouvrier blanc. On va dire le travail, par exemple, le lieu de travail, la question du métier, la question de la corporation, la question de la corporation attachée à des modes de droit et des progressions sociales à ces échelles-là. Et après, c’est vrai que c’est aussi mon bagage de scientifique, que je n’ai jamais été concrètement, mais je viens des sciences dures et la question des échelles de pertinence, ça m’importe. Et je ne sais pas si, en tout cas, l’échelle de pertinence nationale est nécessaire pour penser le rapport entre un micro et un méta. Ne faudrait-il pas poser la question d’une zone intermédiaire comme pourrait le faire Isabelle Stengers. A-t-on besoin de passer par le national pour arriver de l’infranational à l’international ?
Pierre-aurelien Delabre
Après, dans le cadre de l’hypothèse d’une nation décoloniale, le national ne pourra pas se poser en des termes non décoloniaux. Donc déjà, il faut quand même avoir conscience de ça. Je trouve qu’il y a quelque chose d’intéressant dans l’analyse que fait Gramsci, puisque c’est lui à la base qui tente d’articuler toutes ces échelles-là. Il tente de l’articuler en 1917, dans son texte sur la révolution contre le capital, et en 1926, quand il pose la question méridionale. Il s’interroge sur la fracture culturelle, politique, économique qui empêche des paysans du sud de l’Italie de faire alliance avec les ouvriers du nord dans un cadre national pour renverser le fascisme. Et peut-être effectivement qu’il y a une limite chez Gramsci à ce moment-là, et il ne sera plus vivant pour s’en rendre compte, mais en l’occurrence, les Napolitains ne parlant pas nécessairement italien, et étant en tout cas coupés d’une culture nationale populaire, se sont libérés du fascisme en quatre jours. C’est-à-dire que des formes de résistance infranationales déconnectées d’une perspective nationale, ça existe et il faut les considérer. Evidemment, je pense que ce qui est intéressant c’est de ne pas les rendre exclusives les unes aux autres et de tenter de les nouer. Je pense que c’est dans cette tentative de nouer ces différentes échelles que toute la puissance de l’hypothèse d’Houria me paraît saillante.
Mirabelle Thouvenot
Et, dans la pensée d’Houria, il y a quand même un rapport un peu pragmatique à l’histoire et au réel. On ne peut pas nier que l’échelle nationale est ancrée, c’est-à-dire que c’est une composante au-dessus de laquelle on ne peut pas complètement passer. Dans le cadre de la modernité, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été ravagées, abîmées, ce qui a produit des effets sur les attachements régionalistes. Et d’ailleurs il y a certainement des choses qui sont moins abîmées dans les colonies d’outre-mer de par leur distance avec le centre du pouvoir et la métropole. Donc il y a des formes de survivance beaucoup plus fortes qui sont nées aussi des luttes. Il y avait un enjeu beaucoup plus fort à lutter là-dessus. A l’échelle de la métropole française, je pense qu’il y a quand même à prendre en compte aussi le ravage de la modernité occidentale sur les attachements. Après, qu’il y en ait plein d’autres qui puissent se créer, se recréer, se recomposer, ça c’est une évidence aussi, et tu l’as déjà noté, il y a les lieux de travail, les lieux de vie, il y a plein de choses, mais tout ça tend à être abîmé de partout.
Olivier Marboeuf
Je questionnais ça parce qu’au sein d’un mouvement décolonial, les devenirs français sont entre nous différentiels. Tu vois, pour moi, quand je parle avec Houria, elle est beaucoup plus française que moi. C’est-à-dire que selon les modes d’attachement, les zones de vie, les types d’articulation, on n’obtient pas le même rapport à la nation. Je comprends la direction stratégique d’Houria, mais je mets des nuances sur le fait que, par exemple, hier j’étais en Sud-Bretagne, à Quimperlé, dans la librairie Divergence. Et je trouve qu’il y a des zones en Bretagne qui ont une vraie échelle infra du national, qui est extrêmement efficace, extrêmement efficiente, extrêmement attachée. Et la question délicate c’est que l’aspect tradition a été vidé par la droite et l’extrême droite. Du coup, ça crée des détestations sur des attachements qui sont normales, être attaché à un paysage, par exemple, être attaché à un mode de culture, c’est logique. Nous en Guadeloupe où l’île a deux typologies, une plaine où il y a la canne à sucre et puis un volcan, bon ben ceux du volcan c’est pas ceux de la plaine, c’est pas les mêmes attachements, c’est pas les mêmes… Et ça c’est pas pour faire du small is beautiful, c’est pour identifier des échelles de pertinence qui vont effectivement parler à tout le monde. L’échelle nationale, c’est une échelle qui s’est imposée par la force, c’est d’abord une échelle de dévastation qui s’impose à nous. Et longtemps Houria a parlé du devenir blanc, y compris des indigènes, à force d’être pris dans la trame nationale. Au-delà de ces fatalités, je voulais essayer de saisir des choses qui peuvent être efficaces parce qu’elles sont plus joyeuses. Je pense qu’il y a des échelles dans lesquelles, sans se forcer, il y a des choses joyeuses et puis il y a des choses à réenchanter. Pour moi, la nation, c’est quand même à réenchanter. Et il y a des pratiques, joyeuses, qui sont déjà, à mon avis, à notre portée. Tous les Français par exemple qui parlent dans leur région une autre langue que le français. Il y en a quand même quelques-unes en Corse, en Bretagne, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à la Réunion, en Occitanie … Ces détachements se sont des traces de ce qui a résisté à tout ce que la modernité capitaliste a voulu fourrer dans l’appartenance nationale. Elle en parle aussi Stengers. Trouver les traces de ce qui a été détruit, parce que lorsqu’on est au constat de la destruction, on ne se rappelle même plus des modes de vie qui ont précédé.
Pierre-aurelien Delabre
Sur la question de la langue et de la nation comme facteur d’homogénéisation. De fait il n’y a pas que le français aujourd’hui en France. Il y a une multitude de langues et c’est encore plus le cas en Italie d’ailleurs avec la persistance de langues régionalistes. Je pense que ce qui peut être intéressant c’est d’envisager la nation décoloniale comme un facteur d’unité politique mais pas comme un facteur d’homogénéisation culturelle.